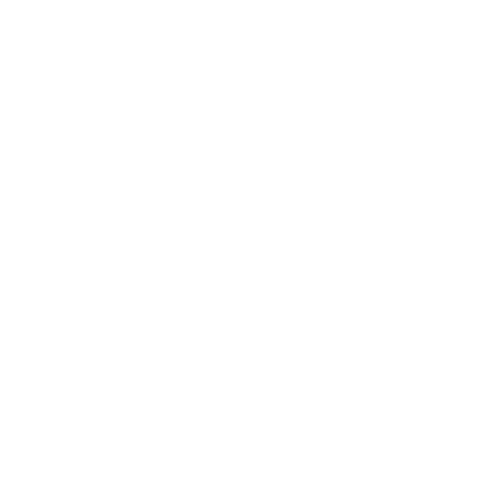"France Tutelle : de la nécessité de mieux faire connaître les mesures de protection"
A la suite de la parution des résultats du baromètre 2025 de France tutelle, retrouvez l'interview d'Anne-lyne Rouget (Présidente de la FNMJI) dans l'article de LEXTENSO - Actu-juridique.fr : "France Tutelle : de la nécessité de mieux faire connaître les mesures de protection".
Article écrit par Delphine BAEUR - Journaliste - 21/10/2025
"Depuis dix ans, France Tutelle accompagne les familles concernées par des mesures de protection, assure la formation des acteurs du secteur et mène des recherches sur le sujet. Les besoins sont importants : Patrick Levard, secrétaire général, parle d’une « courbe exponentielle » de bénéficiaires, puisque France Tutelle accompagne 1 300 familles. Le 16 septembre dernier, l’association présentait son baromètre annuel, un outil indispensable pour appréhender le secteur et ses nouveautés réglementaires. Cette année, focus sur l’habilitation familiale et le mandat de protection future.
Mesurer l’attitude des Français face à la vulnérabilité depuis 2019, tel est l’objectif du Baromètre 2025 de France Tutelle. L’occasion de faire le point sur le lien qu’entretiennent les Français avec les différentes mesures de protection. Constat : parmi les dispositifs juridiques existants, c’est, sans surprise, la tutelle qui reste la mesure la plus connue (à 80 %). Le statut d’aidant, qui consiste à faire bénéficier à un ou une aidante de certains droits et aides, est connu par 82 % des personnes concernées, souligne Federico Palermiti, juriste et conseiller technique de France Tutelle.
Malheureusement, le Baromètre met aussi en lumière le manque de connaissances concernant les autres mesures. Depuis 2019, constate le juriste, « la notoriété des dispositifs de protection juridique n’évolue pas ». 11 % des personnes interrogées n’en connaissent même pas du tout. Et, constat genré, « les femmes connaissent davantage la tutelle, la procuration et les directives anticipées ». Globalement, seules 31 % des personnes interrogées se sentent directement concernées, que cela les touche directement ou leurs proches. Dans cette même veine, peu de Français sont enclins à « prendre des dispositifs pour soi (6 %) ou pour autrui (8 %) ». Federico Palermiti glisse que cela est « dommage, alors qu’il existe précisément un arsenal juridique en France ». En creux, les chiffres démontrent que le sujet de la vulnérabilité constitue encore un tabou : 25 % des personnes n’arrivent pas à se projeter dans une situation de vulnérabilité pour soi (21 % n’y parviennent pas pour leurs proches). Sans surprise également, les émotions que suscite la vulnérabilité sont « majoritairement négatives : de l’angoisse, de la panique, de l’inquiétude, le sentiment de se sentir dépassé », souligne Federico Palermiti.
Il existe deux raisons qui poussent néanmoins à anticiper la vulnérabilité d’un point de vue juridique : faciliter le quotidien pour ses proches (77 %) avec comme motivations premières, la question de la gestion financière, patrimoniale et administrative, et exprimer ses souhaits en matière de santé ou son lieu de vie pour soi (52 %) afin d’éviter d’être une contrainte pour ses proches et s’assurer une plus grande sérénité. Mais malgré le tabou, les besoins sont là : 80 % des Français disent avoir besoin d’informations et de conseils sur les aides, les dispositifs juridiques, les droits et les devoirs des aidants. Tout d’abord, en informant sur les aides, les droits, (55 %), des conseils (45 %) et de l’orientation (36 %). De nouveaux items apparaissent cette année, comme bénéficier d’un échange informel ouvert aux personnes dans la même situation et l’envie d’une formation étendue au grand public.
Un manque de connaissances global
Anne-Lyne Rouget, présidente de la Fédération Nationale des Mandataires Judiciaires Indépendants à la Protection des Majeurs (FNMJI) commente : « Comme le Baromètre le montre, les mesures de protection sont globalement peu connues et elles souffrent notamment de la mauvaise image des mandataires ». Elle évoque les « stéréotypes sur le grignotage des droits individuels. Tutelle, c’est un mot-valise » qui cache la complexité de la protection juridique, regrette-t-elle. Ce manque de connaissances n’étonne pas non plus Nathalie Peterka, professeure à l’Université Paris-Est Créteil (UPEC – Paris 12), où elle dirige le Master Droit privé, le M2 Droit privé des personnes et des patrimoines et le M2 Protection de la personne vulnérable. « Ce ne sont pas des sujets agréables, rappelle-t-elle. Personne n’a envie de se projeter dans sa vulnérabilité. Paradoxalement, il est plus facile de penser à son décès (testament, transmissions patrimoniales…) que d’anticiper sa vulnérabilité ». Cette distance à la matière s’explique de différentes manières : elle précise que le droit des personnes vulnérables n’est enseigné que depuis récemment : il existe donc une question d’acculturation. « Les étudiants jugent cette matière rebutante », note-t-elle, alors que ces réticences ne se rencontrent pas dans le droit des successions et des libéralités.
Anne-Lyne Rouget complète : « Dans les mesures de protection, il existe une dimension émotionnelle. L’impopularité de ces mesures et des métiers qui y sont associés est liée à un profond attachement aux libertés individuelles ». Elle déplore que le médico-social soit trop peu au fait des mesures de protection, et que le secteur y voit trop souvent des attaques liberticides. « Quand les gens s’agacent et se demandent ce que fait la tutrice », elle répond : « elle respecte les contours de la protection juridique et la volonté de la personne ! » Surtout depuis la loi de 2007, qui selon elle, met au cœur du dispositif, les désirs, les envies et prend en compte au mieux la maladie de la personne protégée.
La question de la formation
Nathalie Peterka estime que « la formation des professionnels (conseillers et gestionnaires de patrimoines, avocats, autres professionnels du droit) est essentielle », afin qu’ils puissent délivrer la bonne information. « S’ils ne sont pas formés, ils ne peuvent pas avoir les bons réflexes ». Elle prend en exemple le notariat, qui s’est bien saisi de la question depuis 2020, notamment de cette « zone grise » des personnes qui seraient jugées comme vulnérables, mais pas stricto sensuau sens juridique du terme : comment agir quand face à soi, une personne, progressivement, ne peut ou plus signer un acte juridique ?
Pour Anne-Lyne Rouget, il faut « acculturer les tiers à la mesure des protections ». Elle dit que sa profession est de plus en plus saisie préalablement à la mesure « pour qu’on l’explique aux familles ».
« La vulnérabilité, rappelle enfin la professeure de droit, concerne absolument tout le monde », y compris les chefs d’entreprise. L’anticipation permet de protéger, aussi, ceux qui sont dans l’entreprise pour favoriser sa survie, avant le décès de son dirigeant, et au-delà. La formation est donc indispensable à plusieurs niveaux.
Habilitation familiale ou mandat de protection future ?
Pour le moment, l’habilitation familiale, qui fête ses 10 ans en 2025, reste largement inconnue, puisque seuls 7 % des répondants la connaissent, selon les chiffres du Baromètre. Elle fait face à plusieurs difficultés : considérée comme trop longue pour certains, alors que les situations font souvent face à l’urgence, les difficultés à réunir les informations nécessaires constituant également un frein, sans oublier le manque d’aide et conseils… Pourtant, parmi les mesures de protection, l’habilitation familiale est la plus fréquemment exercée (46 %). Sa spécificité consiste à être une protection exercée par la famille d’une personne vulnérable (un ou plusieurs membres de la très proche famille). « On est parti du principe que la famille resserrée constituait une entité bienveillante et que l’on pourrait lui faire confiance, et qu’ainsi, on n’allait pas lui imposer de rendre des comptes au juge (c’est beaucoup plus souple qu’une tutelle) », rappelle Nathalie Peterka. Le juge doit néanmoins vérifier l’existence d’un consensus familial avant de donner une habilitation familiale. C’est un outil très pratique quand il est bien utilisé mais il existe « un revers de la médaille » : l’opacité de la mesure pour le juge, avec plus de risque de mauvaise gestion. Anne-Lyne Rouget précise : « Je ne suis pas contre le fait qu’un membre de la famille exerce ce mandat. Il existe assez de mesures pour tout le monde. Mais les magistrats doivent être très précautionneux. On voit les retours des habilitations : parfois des abus dans la gestion financière ou une maltraitance financière (en faisant de grosses économies, les personnes en charge pensent préserver l’héritage) ».
Le mandat de protection future n’est lui, exercé que par 7 % des familles. Il est de nature différente. En tant que contrat, il ne peut être conclu que si le mandant est sain d’esprit. Dans le cas contraire, le mandat de protection future ne peut pas être activé. « Cette mesure est une façon de déjudiciariser un contrat par lequel une personne va anticiper sa propre vulnérabilité et ne fait pas intervenir juge des tutelles dans sa mise en œuvre », analyse Nathalie Peterka. Depuis 2021, moins de 2 000 mandats ont été signés. Les notaires sont un peu « frileux » car le législateur impose de procéder à un contrôle de gestion du mandataire, ce qui n’est pas leur cœur du métier (saisie du juge des tutelles en cas d’anomalie, questions de responsabilités…) « Cela explique l’insuccès du mandat de protection future », à cause d’imperfections dans le texte. Sans oublier que l’habilitation familiale a très fortement concurrencé le dispositif. « Pour nous, le mandat de protection future, apparaît un peu comme « contre-nature » car il se fait sans jugement », explique Anne-Lyne Rouget. Elle attend donc une charte de bonnes pratiques, une boîte à outils et un modèle de contrat. Selon le Code civil, le mandat de protection future doit l’emporter sur l’ouverture d’une autre mesure de protection. Nathalie Peterka souligne un « abîme entre le Code civil, la loi et la pratique. Dans la vraie vie, il n’existe pas de moyens de savoir si une personne a signé un mandat de protection future si elle ne le dit pas, il n’existe pas de registre ». Elle ne renie pas une certaine « opacité » dans le dispositif mais confirme qu’il peut s’agir d’un outil intéressant, par exemple, pour un chef d’entreprise qui souhaiterait anticiper la gestion de son entreprise. Dans ce cas, il faut combiner le mandat avec d’autres outils plus compatibles avec le droit des sociétés, conseille-t-elle, par ailleurs.
Federico Palermiti le rappelle : les familles constituent un acteur invisible mais essentiel du secteur de la protection, qui passe un peu sous des radars. Les apports de France Tutelle en termes d’accompagnement des familles sont donc plus attendus et nécessaires que jamais."
Par conséquent, elle ne saurait être tenue responsable du contenu mentionné ou de l'utilisation qui en est faite.